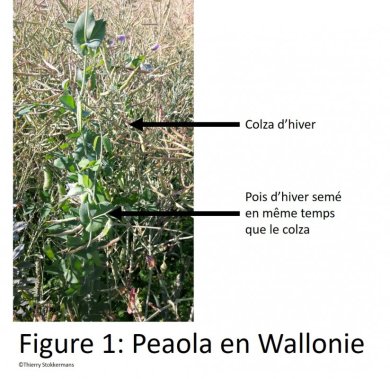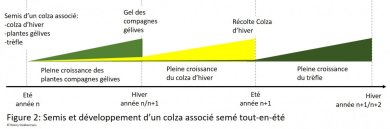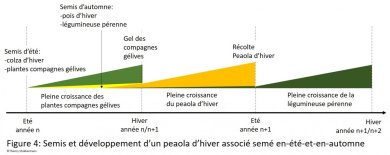Comme dit le proverbe « perception est réalité » et en matière de glyphosate, il y a deux perceptions principales. La première est celle qui domine le monde agricole et scientifique : il ne comporte pas de risques majeurs en conditions normales d’utilisation et il a un rapport coût/efficacité imbattable. En d’autres mots, c’est un bon outil. La seconde est celle qui domine au café du commerce et sur instabook : le glyphosate est un poison qui tue la nature et les hommes et les agriculteurs s’en servent car ils sont égoïstes. Ces 2 perceptions s’opposent. C’est pourquoi il y en a au moins une de fausse, voire les deux. Comment le savoir ? Une seule solution : il faut appliquer la méthode scientifique à tous les étages.
Créer la controverse dont le grand public est si friand
Pour discuter du glyphosate avec le grand public, il faut que la discussion ait lieu dans les médias grand publics. Malheureusement, les journalistes grand publics invitent rarement les agriculteurs ou les scientifiques alors que les militants et les pseudo-experts ont le vent en poupe. Il faut admettre que ces derniers délivrent efficacement un message simpliste et anxiogène. Un excellent terreau pour créer la controverse dont le grand public est si friand. Au-delà du RoundUp de Monsanto, aujourd’hui, la simple évocation de l’agriculture moderne suffit pour créer la controverse.
Le glyphosate a une sale image. Il faut beaucoup communiquer et expliquer pour redorer son blason et freiner l’agribashing. Ici, la communication individuelle est nécessaire mais ne suffit pas. Il faut développer et stimuler la communication de groupe, voire soutenir des initiatives venues de l’extérieur. C’est de cette dernière dont je voudrais vous parler car qui mieux que des citadins peuvent parler du glypho au grand public aujourd’hui.
Un documentaire qui trie l’ivraie du bon grain
 Sugar Rush est une petite boite de production qui, entre autres, fait des documentaires scientifiques. Ils sont basés à Amsterdam, n’ont probablement pas de voitures et se déplacent principalement en bicyclette (les fameux vélos hollandais). Ce sont des urbains et ils font une chose très bien : leurs documentaires sont pragmatiques. Le résultat est frappant. Ils ont produit un excellent documentaire grand public au sujet des OGM appelé « Well Fed ». Ce documentaire trie l’ivraie du bon grain et ça fait du bien à voir. Vous pouvez le regarder ici sur Vimeo et les sous-titres en Français sont disponibles en appuyant sur la touche [CC] (figure 1). Sugar Rush produit des documentaires que l’on aimerait payer avec la redevance.
Sugar Rush est une petite boite de production qui, entre autres, fait des documentaires scientifiques. Ils sont basés à Amsterdam, n’ont probablement pas de voitures et se déplacent principalement en bicyclette (les fameux vélos hollandais). Ce sont des urbains et ils font une chose très bien : leurs documentaires sont pragmatiques. Le résultat est frappant. Ils ont produit un excellent documentaire grand public au sujet des OGM appelé « Well Fed ». Ce documentaire trie l’ivraie du bon grain et ça fait du bien à voir. Vous pouvez le regarder ici sur Vimeo et les sous-titres en Français sont disponibles en appuyant sur la touche [CC] (figure 1). Sugar Rush produit des documentaires que l’on aimerait payer avec la redevance.
En préparation," Les chroniques du Glyphosate"
Sugar Rush est sur un nouveau projet intitulé « The Glyphosate Chronicles » ou « Les chroniques du Glyphosate » en français. Leur but est de clarifier les différentes perceptions et de mettre en avant la vérité. Ayant adoré Well Fed, j’ai hâte de voir The Glyphosate Chronicles. Mais il leur faut d’abord tourner le documentaire et, pour ça, ils ont besoin de sous. Et oui ! La redevance finance le service public et leurs copains mais pas une petite boite de production qui ose se lancer sur des sujets épineux. Pour financer ce projet, ils ont lancé un « crowdfunding » où chacun peut donner ce qu’il veut s’il en a envie. Pour stimuler la campagne de financement, ils ont tourné un « teaser » en France avec Christian Rousseau et Gil Rivière-Wekstein. Moi, j’ai donné 50 euros. Pour donner de l’argent, les détails sont sur leur page The Glyphosate Chronicles et si vous doutez de votre anglais, sachez que leur IBAN est bien NL61KNAB0259113840, leur BIC KNABNL2H et que vous pouvez intituler le virement Glyphosate. Libre à vous.