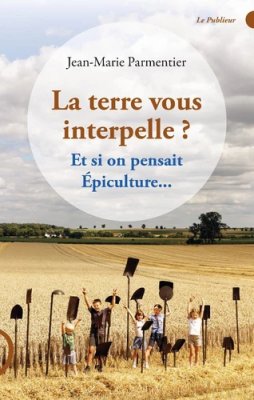Jean-Marc Jancovici, expert français en climat et en énergie, aborde souvent la question de la consommation énergétique et des enjeux écologiques liés à nos modes de vie. Il évoque les chiffres suivants (tirés de rapports du Ministère de l’agriculture, de l’ADEME ou de l’INSEE) pour souligner plusieurs points critiques concernant notre système économique et alimentaire :
– 15% du budget des ménages est alloué à la nourriture
– 7% de la part du prix payé par le consommateur pour un produit alimentaire est effectivement versée au producteur
— > si on fait un rapide calcul de coin de table (merci à l’agriculteur qui m’a soufflé l’idée) : 7% de 15%, ça fait 1% du du budget des ménages qui est reversée au producteur ...
En résumé, Jancovici utilise ces chiffres pour dénoncer un modèle où l’agriculture et les producteurs sont largement désavantagés, et pour souligner l’urgence de repenser la distribution des ressources et de soutenir des pratiques agricoles plus durables.
En détail :
- Distribution inégale des revenus dans la chaîne alimentaire : Jancovici met en lumière l’inadéquation de la répartition des ressources financières dans la chaîne de valeur alimentaire. Alors que les ménages consacrent une part importante de leur budget à la nourriture (environ 15%), une part très faible de cet argent va réellement au producteur, soit 7%. Cela signifie que la majorité de l’argent payé pour les produits alimentaires est absorbée par les intermédiaires : industriels, distributeurs, transporteurs, et autres acteurs de la chaîne logistique.
- Les marges des entreprises de transformation et de distribution : Il pointe l’énorme profit généré par les grandes entreprises du secteur alimentaire, souvent au détriment des producteurs, qui reçoivent une fraction minime de l’argent dépensé par les consommateurs. Jancovici met ainsi en lumière les problèmes de rentabilité pour les agriculteurs, qui se retrouvent souvent dans des situations économiques précaires, malgré le fait que leurs produits soient en fin de chaîne valorisés à des prix beaucoup plus élevés.
- Conséquences écologiques et sociales : Selon lui, cette concentration des marges sur les maillons intermédiaires a des impacts négatifs, notamment sur l’agriculture durable et la transition énergétique. Les producteurs, souvent contraints par les faibles prix qu’ils reçoivent, sont moins incités à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement. Cela alimente un système où l’impact écologique de la production alimentaire reste élevé, car la rentabilité des fermes est sacrifiée au profit de la rentabilité des grandes entreprises agro-alimentaires.
Jean-Marc Jancovici a créé "the shift project". Cette équipe d’experts publie des rapports pour expliquer et donner des conseils pour diminuer l’empreinte carbone de différents secteurs. Son dernier rapport traite de l’agriculture : "Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère"
Pour ceux qui veulent tout le rapport et son résumé :https://theshiftproject.org/article/pour-une-agriculture-bas-carbone-resiliente-et-prospere-the-shift-project-publie-son-rapport-final/
On trouve dans ce lien également, le résultat de la grande consultation des agriculteurs qui a récolté près de 8000 répondants.
Cet article m’a été inspiré par la dernière vidéo postée sur le site A2C (voir la rubrique vidéo en page d’accueil de ce site). Vidéo elle-même recommandée par un éleveur belge.