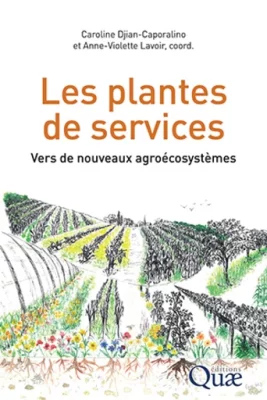Un piège dans lequel ne pas tomber.
La biostimulation et le biocontrôle suscitent de nombreuses questions. Entre promesses scientifiques et réalité du terrain, leur efficacité et leur coût suscitent des réserves. Brieuc Hardy, chercheur au Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), et Philippe Jacques, professeur à Gembloux Agro-Bio Tech, ont présenté l’état de la recherche en Belgique sur ces nouvelles alternatives dans un webinaire.
– De la minute 3 à la 15 : les biostimulants
– De la minute 15 à la minute 27’30’’ : le fonctionnement biologique des sols
– De la minute 27’30’’ à 49’30’’ : le projet micro soil system et les mycorhizes (minute 48’26" "il y a de très bons produits")
– De la minute 50’ à la minute 1h06’30" : les produits de biocontrôle*
Pour ceux qui préfèrent la lecture à la vidéo, le Sillon belge a très bien résumé la situation dans son édition du 8 janvier 2026 (quoiqu’un peu plus optimiste que le webinaire) : "Biostimulation et biocontrôle : quand les micro-organismes soutiennent l’agriculture".
*Le professeur, Jacques Philippe, a entre autres présenté l’Initiative d’innovation stratégique (IIS) Digibiocontrôle qui rassemble tous les partenaires wallons publics et privés impliqués dans la recherche et le développement de biosolutions avec l’aide des outils numériques. Il a également mentionné le projet Interreg Biocontrol 4.0 qui mobilise 43 partenaires belges et français autour du sujet du biocontrôle.