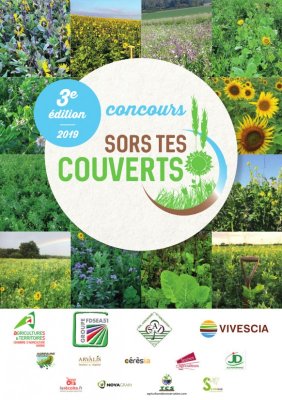- Plantation d’une haie avec une planteuse forestière
- Installation d’une haie sur la ferme de Philippe Jacquemin, à Sompuis dans la Marne. Le prestataire a, pour cela, utilisé une planteuse forestière qui ouvre un sillon grâce à 2 disques, permettant à l’opérateur, assis à l’arrière de l’outil, de planter, en direct, chaque plant, racines nues. Deux roues plombeuses finissent l’implantation.
Un reportage est consacré à la ferme de P. Jacquemin dans le TCS de l’automne 2021
La vie, c’est le mouvement. Bouger pour se nourrir, bouger pour trouver à se reposer, bouger pour échapper à un danger, bouger pour se reproduire ou encore bouger pour trouver un nouveau territoire. Il y a des tas de raisons au déplacement. Même le monde végétal bouge et a trouvé des solutions pour le faire. Mais pour cela, il ne doit pas y avoir d’entraves au déplacement. Sinon, cela peut compromettre la survie et l’existence même de l’individu, d’une population ou pire, de l’espèce !
Or, chaque espèce a sa propre façon de bouger avec ses propres exigences d’alimentation, de reproduction, de dispersion etc. Un environnement accueillant pour la biodiversité l’est pour toutes les espèces qui le composent et pas seulement pour les espèces qui vous seraient utiles….
Notions de réservoirs et de corridors
En écologie (au sens premier du terme, scientifique), un réservoir de biodiversité est un espace où la biodiversité est la plus riche d’un territoire ou, tout du moins, la mieux représentée. Dans un réservoir de biodiversité, les espèces y assurent tout ou partie de leur cycle de vie, permis par un habitat naturel suffisant. Une forêt est un réservoir de biodiversité. Une prairie à la flore diversifiée l’est aussi, tout comme un couvert végétal d’interculture multi-espèces (seul bémol : il est temporaire). Un cours d’eau est aussi un réservoir de biodiversité mais aussi un vieil arbre isolé !
Afin d’assurer tout leur cycle de vie mais aussi le nécessaire brassage génétique entre populations d’une même espèce, les réservoirs de biodiversité doivent être connectés les uns aux autres, via des corridors écologiques (ou biologiques), permettant la libre circulation des individus. On imagine toujours un corridor écologique comme un élément linéaire, une haie, une rangée de végétation, un cours d’eau, une bande enherbée. Les corridors, vus à une échelle plus grande, ne sont pas toujours contigus. Ce peut être, par exemple, des bosquets disséminés dans un paysage agricole, proches les uns des autres mais participant, néanmoins, à l’interconnexion des espèces. N’oublions pas que si certaines espèces se complaisent dans un biotope plutôt fermé, d’autres ont besoin de milieux ouverts pour vivre. Un exemple : la chauve-souris. Certaines espèces comme les rhinolophes suivent des linéaires pour se déplacer et rejoindre, pour chasser, des espaces ouverts tels que des parcelles agricoles.
Nécessaire connectivité
En termes de protection de la biodiversité, on a trop longtemps abordé le problème uniquement sur le plan du réservoir. Or, il ne suffit pas de permettre l’implantation d’une haie ou d’une mare si celles-ci se retrouvent isolées dans leur environnement. Il est urgent de repenser la problématique sous l’angle de la connectivité entre réservoirs de biodiversité. Il faut des réservoirs mais il faut AUSSI des corridors. C’est ainsi que, de plus en plus, par exemple, des passages à faune sont aménagés pour palier à l’entrave énorme que représentent les infrastructures routières pour le déplacement des espèces.
Dans certains agroécosystèmes (je pense, notamment, aux grandes plaines céréalières très ouvertes), il faut repenser l’organisation du paysage en imaginant de nécessaires corridors, sous la forme parfois de haies mais pas seulement : ce peuvent être ici, des bandes enherbées, ici des fossés avec bandes enherbées, là des lignes agroforestières etc. Il faut des corridors diversifiés, de l’herbe à l’arbre. Attention, on ne dit pas qu’il faut revenir, partout, à du paysage de bocage ! Non, il faut juste repenser intelligemment l’espace, en ayant bien en tête ces notions de réservoirs de biodiversité et de corridors biologiques et, en prenant également en compte, tout ce qui fait la vie d’un agroécosystème comme vos propres activités de production et leurs impératifs.