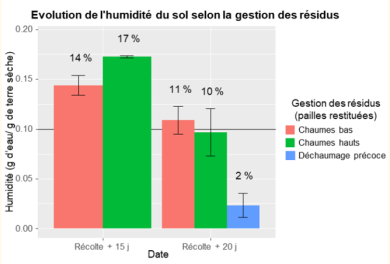Si vous disposez d’un combiné herse rotative - semoir à disques, il vous est possible de réduire ponctuellement l’intensité du travail du sol et de vous initier au semis sous couvert, avec le matériel déjà présent sur votre exploitation. Voici quelques exemples pour vous encourager à franchir le pas.
Dans le TCS n°87 de mars/avril/mai 2016, je vous parlais de Christine et Sébastien Rousseau, agriculteurs de la Chapelle-Iger (77) qui, suivant l’exemple du frère de Sébastien, semaient avec succès depuis 2009 des céréales (blé de féverole, blé de blé et orge de printemps) avec un combiné herse rotative/semoir à disques directement dans un couvert en place, sans broyage ni mulchage préalable. La herse rotative travaille à peine plus profond (1 à 2 cm plus creux) que la profondeur de semis. Les semences de céréales sont bien positionnées, il n’y a pas de bourrage ni dans la herse, ni dans les éléments semeurs. Les résidus du couvert se retrouvent quelque peu « andainés », mais cela n’est pas une gêne à la levée de la céréale.
Notons que les semences des couverts couvrant les intercultures féverole-blé, blé-blé et blé-orge de printemps sont épandues avec un DPS 12 et enfouies par un passage de déchaumeur à disques indépendants, qui gère à cette occasion les pailles de blé.
Nouvelles opportunités
Dans le TCS n°125 de novembre/décembre 2023, Christine et Sébastien nous indiquaient qu’ils pratiquent cela moins souvent désormais, d’une part car les couverts sont plus développés et donc plus difficiles à gérer directement avec la rotative du combiné, et d’autre part parce qu’il leur faut souvent reniveler les parcelles à cause des dégâts de sangliers. Disons aussi que l’arrivée récente d’un semoir de semis direct sur l’exploitation offre également de nouvelles opportunités.
D’autres agriculteurs utilisent toujours cette technique d’implantation de nos jours. Par exemple, Vincent Tomis, agriculteur de Gœulzin (59), la pratique depuis qu’il s’est équipé d’un combiné avec un semoir à disques, en 2018, pour des semis de blé après colza, pois et lin fibre, dans les repousses de ces cultures et dans les couverts d’interculture.
De son expérience, lorsque la biomasse du couvert est supérieure à 2,5 ou 3 t MS/ha, il vaut mieux broyer le couvert au préalable, pour ne pas dégrader la mise en terre des semences et pour éviter que les vesces ne s’enroulent trop dans les dents de la herse rotative.
S’initier sans investissement lourd
Vincent ne sème pas de blé de blé ainsi. En effet, sa moissonneuse batteuse n’est pas équipée d’éparpilleur de menues pailles et broie mal la paille. En l’absence de travail du sol avant le semis du blé de blé (le couvert d’interculture étant semé à la volée avant la moisson du premier blé), les pailles et menues pailles, mal broyées et mal réparties, gêneraient l’implantation du blé de blé et favoriseraient les limaces.
 |
À condition de disposer d’un combiné herse rotative/semoir à disques, il est donc possible de réduire ponctuellement l’intensité du travail du sol et de s’initier au semis sous couvert sans investissement initial lourd, avec du matériel déjà présent sur l’exploitation. Un couvert ayant produit une forte biomasse n’est pas un problème, il suffit de le broyer au préalable (en veillant à la faune qui y trouve refuge), la plus grosse gêne peut provenir des pailles et menues pailles de céréales si elles sont mal broyées et mal éparpillées.