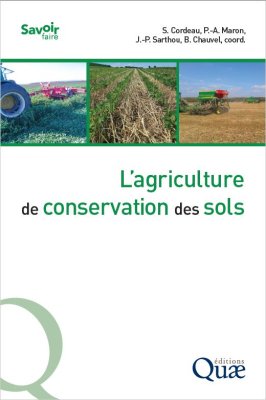ATTENTION, IL NE RESTE QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE !!!
 Vous souhaitez relever le défi du plus beau couvert végétal ? Participez à la nouvelle édition du concours « Sors tes couverts ! ».
Vous souhaitez relever le défi du plus beau couvert végétal ? Participez à la nouvelle édition du concours « Sors tes couverts ! ».
Pour cette nouvelle édition, le concours a été décliné par les chambres d’agriculture sur deux départements : l’Oise et la Somme avec toujours le même objectif : valoriser les pratiques des agriculteurs sur leurs couverts d’interculture !
Le concours se déroule en deux phases :
• Phase 1 : jugement sur la composition du couvert et des photos envoyées par les agriculteurs ;
• Phase 2 : visite des parcelles avec des pesées de biomasse des espèces présentes.
La phase 1 fait office de pré-sélection et la phase 2 élabore le classement général : 10 parcelles seront retenues pour les deux départements.
Comment bien choisir ses espèces de couvert pour remporter le concours ?
Le choix des espèces est primordial pour avoir de beaux couverts, l’idéal est de mélanger les espèces et les familles pour obtenir au moins 3-4 espèces de familles différentes : crucifères, graminées, légumineuses ou une autre famille comme les astéracées.
Un bon mélange permet de garantir une bonne couverture du sol, tout en optimisant l’occupation de l’espace avec des plantes complémentaires au niveau racinaire et aérien. Le mélange des espèces permet de combiner les bénéfices : structure du sol, restitution de l’azote, piège à nitrate, attrait des pollinisateurs, etc.
Dans le choix de ces couverts, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs : les bénéfices recherchés, la succession culturale et la conduite culturale des couverts.
Bénéfices à rechercher :
Les couverts d’interculture apportent de nombreux bénéfices, qu’ils soient agronomiques (structure du sol, restitution de l’azote, piège à nitrate, contrôle des adventices…) ou environnementaux (ressource en auxiliaires, protection du sol…). Le choix des espèces à intégrer dans le couvert doit être orienté par ces objectifs. En effet, chaque espèce a ses caractéristiques propres, ainsi elles rendent des services différents.
Par exemple, la moutarde, du fait de sa biomasse élevée et de sa croissance rapide, a un effet important sur le piégeage des nitrates. A l’inverse, les légumineuses, du fait de leur activité symbiotique, ont un effet sur la fourniture en azote pour la culture suivante.
Choix des couverts en fonction de la rotation :
Le choix des espèces présentes dans les couverts doit se raisonner en fonction des cultures présentes dans la rotation et notamment en fonction de la culture suivante. En effet, le couvert peut avoir des effets positifs comme négatifs pour les cultures. Le principal objectif est de limiter les risques sanitaires en évitant de choisir des espèces de couverts favorisant la multiplication de bioagresseurs susceptibles d’impacter les cultures.
Conduite des couverts :
Il existe différents types d’implantation possibles : les semis à la volée avant la moisson et les semis de post-récolte.
Les semis de couverts dans la culture en précédente est une pratique permettant de gagner du temps lors de l’implantation tout en maximisant la durée de végétation des couverts et leur croissance. Le principe de cette technique est de placer les graines de couverts sur le sol puis de les recouvrir avec les pailles de la céréale précédente. Ainsi, la graine bénéficie de l’humidité résiduelle du sol conservée par la culture ou le mulch de paille. Le semis peut se faire grâce à des DP12 ou des épandeurs centrifuges. Au centrifuge, la balistique des semences dépend de la taille des graines. Pour obtenir un semis homogène, des solutions sont proposées par les semenciers : mise en pellet des semences ou enrobage individuel des petites graines d’un mélange. La mise en pellet peut aussi être réalisée soi-même grâce aux recettes proposées dans différents projets. Un semis le plus proche de la moisson (10 jours à 1 semaine avant la moisson) permet d’obtenir de meilleures levées et un bon taux de réussite.
En règle générale, les couverts végétaux sont implantés après la moisson. Plusieurs méthodes sont possibles : le semis direct le plus tôt possible après le passage des batteuses, le semis à la volée puis déchaumage ou encore le déchaumage puis le semis en ligne. Les semis avec un semoir à semis direct ou un semoir classique permettent d’utiliser une plus grande diversité de graines (espèces, tailles…) et permettent également d’obtenir de bonnes conditions de levées et de réussite des couverts végétaux.
Quel que soit les couverts ou les types de semis, une précaution supplémentaire doit être prise cette année, face à la pression en limace, notamment pour les semis en direct et à la volée avant moisson.
Pour vous aider à choisir les espèces adaptées à vos objectifs, vous pouvez utiliser l’outil « choix des couverts » développé par Arvalis, en collaboration avec Terres Inovia et l’ITB.
Les partenaires du concours pour l’édition 2024 (au 25 juillet 2024) :![]()
POUR VOUS INSCRIRE, trois possibilités :
– Via la feuille d’inscription ci-jointe
– en ligne, via ce lien : https://forms.office.com/e/pMrfGZYZG9
– en flashant le QRCode sur l’affiche du concours.
ATTENTION, VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 OCTOBRE !

Pour participer au concours ou avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
– Sophie WIERUSZESKI (06-73-45-50-74), chargée de mission agroécologie et expérimentation à la chambre d’agriculture de l’Oise,
– Julie RICHARD (06-82-36-59-05), conseillère en productions végétales à la chambre d’agriculture de la Somme.